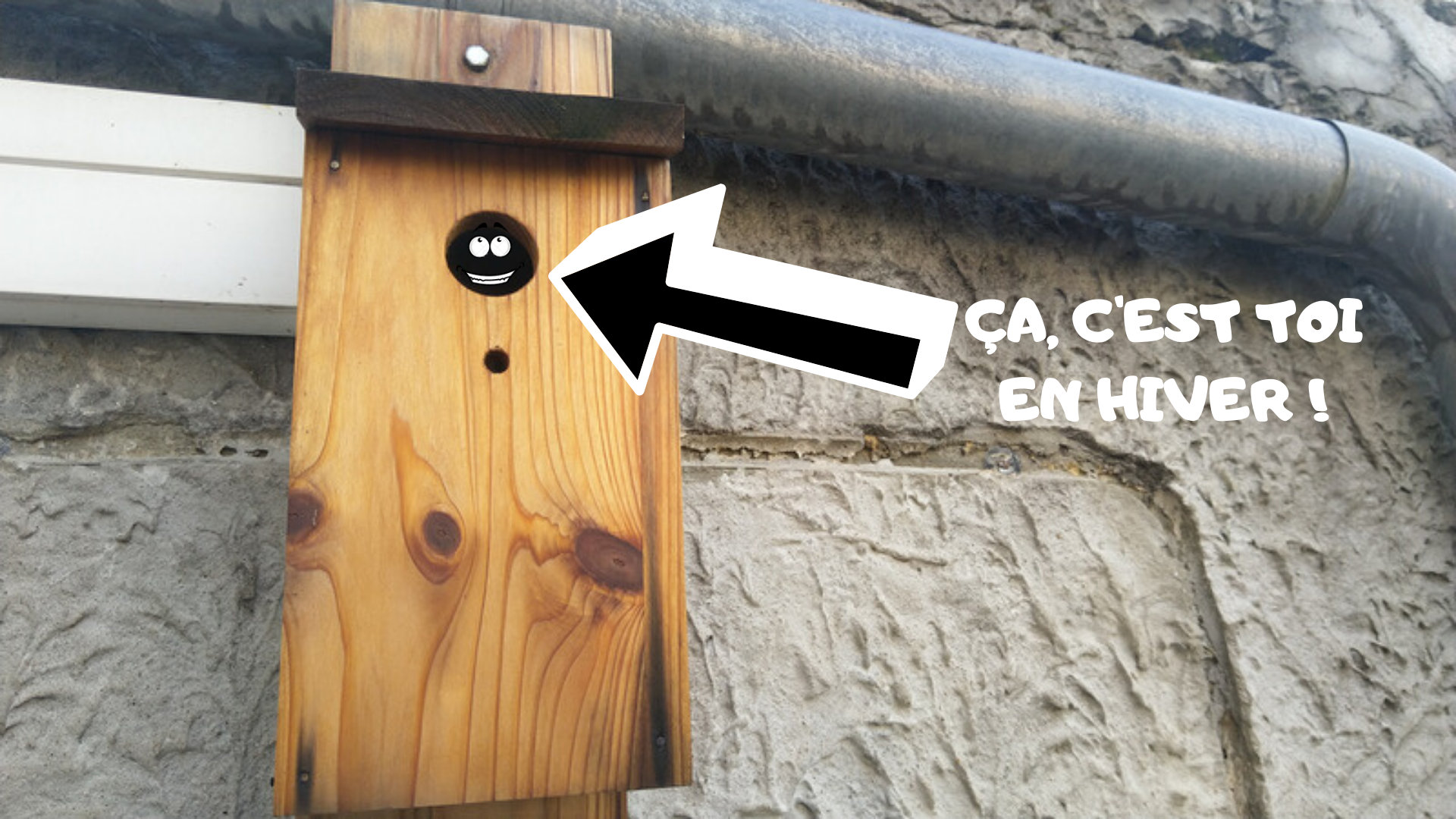par Fabrice | Juil 8, 2020
Le jardin c’est l’école de la vie.
Peut-être que vous avez des enfants et que les seules activités que vous leur faites faire c’est de vous donner un petit coup de main pour la plantation et l’arrosage.
Pourtant, il y a un tas de choses à faire pour les éveiller au jardinage comme faire germer une graine et suivre son cycle..
..observer les insectes qui viennent lui rendre visite..
..observer la vie du sol sous le paillage..
..mettre les mains à la terre..
..faire un herbier sur un téléphone..
..construire un tipi en bambou pour tuteurer un plant de tomate..
..etc…
Tout ça c’est cool.
Ca leur fait faire des activités manuelles et pédagogiques.
Ca éveille leurs sens et c’est bien mieux qu’une simple session d’arrosage occasionnelle.
Pourtant, il y a une chose de laquelle ils apprendront énormément.
Une chose tellement enrichissante, qu’elle restera dans leur mémoire toute leur vie.
Mon premier contact avec le jardinage
Quand j’étais petit, j’ai eu une période où je faisais germer plein de graines sur mon balcon.
Graines de citron, graines de pomme, etc.. tout y passait ! (j’ai même gardé un marronnier une demi-douzaine d’années dans un pot de fleurs).
Je me souviens encore de tous ces petits instants où j’observais ces graines germer et grandir.
Ces moments où je les arrosais, je sentais leur parfum, je les touchais, etc..
Et il est là mon conseil :
Si vous avez des enfants, je vous invite à leur donner la responsabilité d’un pot de fleurs (ou d’un morceau de jardin).
La règle d’or : ne pas intervenir
C’est leur responsabilité.
Vous avez le droit de les prévenir si la plante a soif par exemple, mais c’est tout.
Tant pis si la plante meurt.
Pas de désherbage ou d’arrosage en douce.
C’est à eux de s’en occuper et d’apprendre de leurs erreurs.
Bon, vous allez me dire qu’il est un peu tard pour faire germer des plantes au jardin et que de toute façon vous n’avez plus de graines.
Faux !
Il y a toujours un pot de fleurs ou un coin de jardin vide et il y a toujours une graine qui traîne à la maison (citron, pomme, orange, tomate).
De plus, tout germe en ce moment au jardin (c’est la magie de l’été).
Faites marcher votre créativité !
Il y a tout un tas d’activité à faire au jardin avec les enfants comme par exemple l’expérience du ver de terre ou les têtes à pousser faites avec des coquilles d’œufs.
Et si vous avez un chat, pourquoi ne pas faire pousser de l’herbe à chat ?
PPS : je suis curieux de savoir ce que vous avez l’habitude de faire au jardin avec vos enfants..
..dites-le-moi en répondant à ce mail !
par Fabrice | Avr 25, 2020
Une recette de purin d’ortie très simple !
Mercredi je vous ai parlé de vos semis et du fait qu’ils ont certainement pris un coup de mou ces derniers jours…
Et bien avec cette recette de purin d’ortie, vous allez pouvoir leur donner un petit coup de boost (il va juste falloir attendre deux petites semaines…).
Mais avant de passer concrètement à la recette, c’est quoi le purin d’ortie ?
Je ne suis pas un scientifique du purin d’ortie et du purin de plantes en général.
Mon truc à moi, c’est de faire les choses le plus simplement possible et avec les moyens du bord.
C’est la permaculture quoi !
On va dire que je vois ça comme une sorte de thé géant aromatisé à l’ortie que je vais donner à mes plantes (et elles vont kiffer).
En 2 mots, un purin d’ortie c’est prendre de l’ortie, la mettre dans un récipient avec de l’eau et laisser tremper pendant une bonne dizaine de jours.
C’est quoi un purin d’ortie et à quoi ça sert ? ?
En gros, un purin c’est diluer les meilleures caractéristiques d’une plante dans l’eau afin de les réutiliser sous la forme liquide.
Oui, il y a une sorte de macération (ou putréfaction, ça dépend 😂) mais ce qui nous intéresse c’est le résultat.
Mais alors, à quoi sert le purin d’ortie ?
Comme je vous le disais au début de ce mail, ça sert à donner à manger à vos semis mais aussi à vos jeunes plantations.
En fait, l’ortie est riche en azote, elle a un effet « vert » sur vos plantes.
C’est-à-dire qu’elle leur redonnera de la vitalité au niveau du feuillage.
Du coup, ce n’est pas le meilleur purin de plantes à donner à vos plantes si elles sont sur le point de fleurir… (pour ça, préférez le purin de consoude qui est riche en potasse)
Bref, dans la période avril/mai/juin, le purin d’ortie c’est le top !
Il a aussi d’autres utilités.
Il sert à booster la décomposition de la matière organique (dans le compost par exemple).
Du coup, si c’est la première année que vous lancez votre potager (ou votre lasagne en pot de fleurs) et que votre sol n’est pas encore très vivant, faites un apport de matière organique et arrosez au purin d’ortie, c’est magique !
Le matériel pour faire un purin d’ortie
Alors la première étape c’est de trouver un récipient avec un couvercle.
Ne vous amusez pas à découper la première bouteille en plastique qui vous passe par la main en pensant qu’un mini-purin d’ortie fera l’affaire !
Il faut au moins un récipient de 15 – 20 litres (pour moi, c’est le strict minimum, après vous pouvez aller jusqu’à 1000 litres, le principe reste le même).
Un élément important, il vous faut un couvercle.
Ce n’est pas indispensable mais si vous voulez garder une bonne relation avec vos voisins c’est mieux parce que le purin d’ortie, ça pue (surtout quand vous allez le mélanger).
D’ailleurs c’est la deuxième chose qu’il vous faudra, un truc pour mélanger.
Morceau de bois, manche à balai, etc…
A vous de voir mais éviter de vous en mettre plein les mains (c’est bon pour la peau mais l’odeur reste imprégnée de longues heures…).
Ensuite il vous faut de l’ortie !
Pour ce qui est de la période de cueillette, en ce moment c’est l’idéal parce qu’elle n’est pas encore en fleurs, ni en graines.
Quelle quantité d’ortie pour le purin ?
Pour ce qui est de la quantité, ma technique est simple : à vue d’œil.
En gros, vous devez en avoir assez pour remplir votre récipient (sans (trop) tasser).
Une fois que c’est fait (et avant de le remplir d’eau), placez votre récipient rempli d’ortie à l’ombre et à un endroit où ce sera facile pour vous de vous y rendre quotidiennement.
Ensuite, ajoutez l’eau dans votre récipient (remplissez jusqu’au 2/3 voir un peu plus) et mélangez un peu.
Refermez et laissez macérer (ou infuser si vous préférez).
La macération
Revenez chaque jour pour mélanger et observer le processus (par contre allez-y à l’heure de la sieste pour ne pas déranger les voisins, ça pue vraiment 😂).
Au bout d’une dizaine de jours, votre mélange sera prêt (en gros, c’est au moment où il aura bientôt fini de faire ses bulles).
A ce moment-là, enlevez les orties (et pensez à les réutiliser au potager ou au compost ;)).
Quand utiliser le purin d’ortie ?
Le purin doit être utilisé dans les jours qui viennent en le diluant à environ 10 – 15 % (pour faire simple c’est une ou deux doses de purin pour 10 doses d’eau soit un peu plus d’un litre pour 10 litres d’eau.
S’il vous en reste et que vous voulez le stocker pour le réutiliser dans quelques semaines voir quelques mois, il va falloir le filtrer pour arrêter la macération.
Le stockage se fait dans le noir et au frais (environ 20°C).
Et plus vous filtrez fin, plus votre purin d’ortie se conservera longtemps.
Vous pouvez utiliser une passoire plus ou moins fine, un filtre à café réutilisable, des collants, etc… et pour ça je vous laisse libre de vous organiser par vous-même ! (ou ce sera l’objet d’un prochain mail si le sujet vous intéresse..).
Et pour finir, cuisiner l’ortie ?
S’il vous reste des orties après la cueillette, sachez que c’est une plante comestible et très riche en nutriments.
Vous pouvez aussi la cuisiner en soupe, tarte, chaussons, etc…
J’espère avoir été simple, rapide et efficace pour cette recette de purin d’ortie.
N’hésitez pas à me faire votre retour en commentaire.
par Fabrice | Jan 24, 2020
Oui, vous pouvez tout à fait mettre la peau de banane au compost ! Riche en azote, potassium et phosphore, cette épluchure accélère la décomposition des déchets organiques et enrichit le terreau final, idéal pour le potager ou les plantes d’intérieur. Pensez à retirer l’étiquette autocollante et, si la banane n’est pas bio, vous pouvez la rincer brièvement pour limiter les résidus de pesticides.
Dans cet article, je vais revenir en détail du pourquoi du comment la peau de banane se décompose bien et pourquoi je n’hésites pas à en balancer dans mon compost et même dans la nature !
La peau de banane est-elle compostabe ???
La semaine dernière j’étais en balade à la campagne avec des amis.
Comme à mon habitude, j’ai jeté mécaniquement la peau de la banane que je m’apprêtais à manger dans la lisière d’une haie.
Et oui, je suis un « pollueur organique » assumé
Que ce soit en ville ou à la campagne, je ne jette jamais de matière organique dans une poubelle !
Et je suis intransigeant là-dessus
Toute personne qui composte est incapable de jeter ne serait-ce qu’un trognon de pomme dans une poubelle classique (si vous ne me croyez pas, essayez le compostage, vous verrez bien !).
6 à 8 mois pour se décomposer !
Bref, une amie m’a vu et m’a dit que je ne devrais pas faire ça car une peau de banane met très longtemps à se décomposer (chose que je ne consens pas du tout et je vous explique pourquoi juste après).
…
Effectivement, je viens de regarder sur internet et c’est confirmé : « une peau de banane met très longtemps à se décomposer (8 à 10 mois) ».
Déjà, j’ai envie de dire : « Et alors ? On s’en fout ! ».
Qu’elle mette 3 semaines ou 3 ans à se décomposer, dans tous les cas elle finira par le faire (ou elle ravira l’estomac d’un mammifère amateur de cuisine exotique).
Bon, trêve de plaisanteries.
Après quelques années de lombricompstage, de culture en lasagne en pots de fleurs et de compostage de surface, je peux affirmer haut et fort que j’ai rarement vu une peau de banane aller au-delà de 8 à 10 mois de compostage.
Je n’ai pas fait de calcul mais en général, sur ma terrasse, elle ne survit pas plus de 3 mois (et je suis très très large).
Laissez-moi vous expliquer.
Les facteurs clés du compostage
L’un des facteurs clés d’un bon compostage c’est l’humidité.
Par exemple si vous mettez une peau de banane en plein cagnard sur un sol sec et envahit de chiendent, c’est sûr qu’elle va mettre beaucoup de temps à se décomposer.
Elle va noircir puis sécher et très peu de micro-organisme auront le courage de venir la grignoter.
Par contre, si vous la mettez sous un lit de feuilles mortes riches de vie et bien humides, je peux vous assurer qu’elle ne fera pas long feu (et qu’elle fera le bonheur des vers de terre et des micro-organismes !).
Une deuxième chose.
Personnellement je suis un gros consommateur de bananes.
Décidément je parle beaucoup de moi aujourd’hui.
J’en mets souvent dans le lombricomposteur et s’il y a bien une chose que les vers de compost raffolent plus que tout, c’est la peau de banane !
J’aime observer ce qui se passe dans le lombricomposteur et je peux vous dire que quelques jours après avoir mis une peau de banane, ils sont nombreux à se la partager !
Si vous avez un lombricomposteur, tentez l’expérience 😉
Il suffit de poser la peau (pointe vers le haut comme dans Mario kart) sur le tas de lombricompost bien humide.
Quelques jours après vous pouvez être sûr de trouver une flopée de vers sur le côté intérieur de la peau 😉
Bref, la morale de l’histoire : la prochaine fois que vous mangez une banane, n’hésitez pas à jeter (discrètement) la peau dans un massif de plantes (et n’oubliez pas de retirer les étiquettes 😉 ).
PS : en parlant de peau de bananes, voici une recette d’engrais naturel à base de peau de banane et de marc de café.